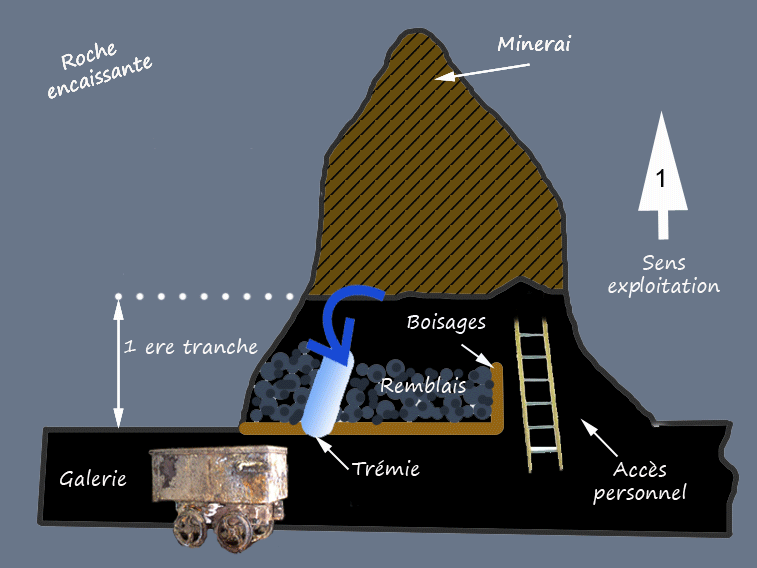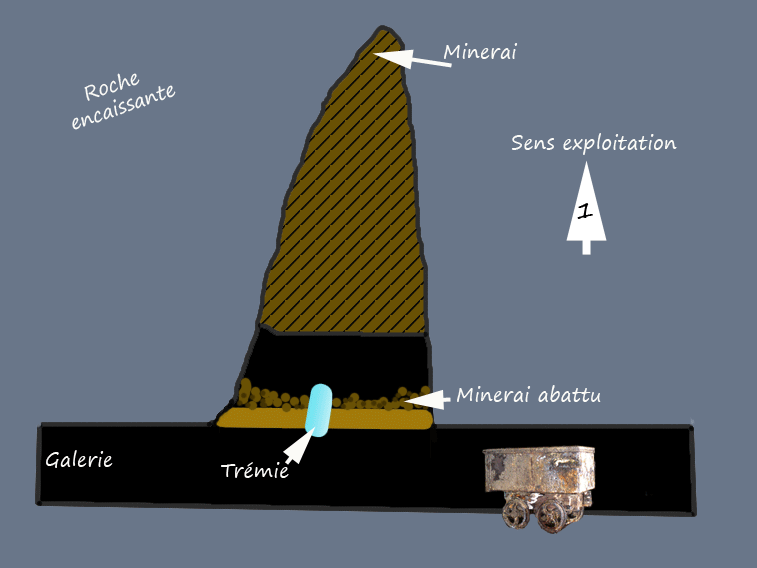Pendant quelques jours, sous un soleil de plomb nous sommes partis sur les traces du fer sur ces paysages quelque peu chamboulés par les anciennes activités minières. Je vais essayer de vous faire profiter de nos observations et des choses apprises.(La définition des mots en rouge se trouve dans le glossaire Mines)
Le minerai de fer Lorrain appelé minette est très riche en phosphate et relativement pauvre en fer. Dans le passé, seul le « fer fort » était exploité. Contenu dans des
poches géologiques le rendement de son exploitation était faible. A partir du milieu du 19 ème siècle la mise au point du
convertisseur Thomas a permis de rendre l’exploitation du minerai phosphaté rentable.
C’est une aubaine pour le bassin Lorrain dont la sidérurgie devient une des plus importante du monde.Pendant plus d’un siècle, les mines de Lorraine sont exploitées avec la méthode dite du « traçage ». Les galeries sont creusées perpendiculairement à la galerie principale, puis on recoupe également perpendiculairement ces galeries par des recoupes secondaires, le minerai est extrait en laissant des piliers qui servent de
soutènements.
Ensuite les piliers sont abattus (foudroyage) afin de ne pas laisser de vide.

Le comblement des vides par éboulement volontaire évite le danger d’un effet domino.
L’affaissement d’un pilier pourrait provoquer un vaste effondrement en cascade. Mieux vaut prévenir que..subir!!!
La gestion de l’eau pendant la mine :
Le bouleversement de la masse encaissante et le phénomène de drainage que provoquent les galeries entraînent une profonde modification de la nappe aquifère tout au long de l’exploitation. Cette eau doit être évacuée de la mine soit par des galeries d’écoulement gravitaires qui rejoignent l’air libre soit par pompage. Pour cela une galerie peut être fermée par un muret, le tout formant un réservoir appelé albraque.

Toute cette gestion de l’eau se nomme exhaure.
Cette eau est utilisée pour l’alimentation en eau potable et comme ressource pour les laverieset industries avoisinantes.Après l’exploitation, l’eau n’est plus pompée, les galeries se remplissent d’eau: c’est l’ennoyage. Un nouvel équilibre hydrodynamique se forme. Il reste sous surveillance car les foudroyages ont modifié les couches marneuses en perturbant leur imperméabilité et les couches karstiques sont fissurées. De plus, les mouvements de l’eau peuvent saper les piliers restants. Il existe donc des
risques d’affaissements ou de vidage brusque d’une poche aquifère avec de conséquences perturbantes en surface.
Avant l’exploitation

Après l’exploitation

Dans les années 50 grace à la puissance du matériel americain (jumbo etc.) la productivité augmente considérablement passant de 12,3 tonnes/hommes/poste à 50 tonnes/homme/poste.Mais :Extrait wikipédia:Après une durée d’exploitation d’environ un siècle et demi, la masse de minerai arrachée au sous-sol lorrain serait de trois milliards de tonnes. Cependant, la trop faible teneur en fer de ce minerai, sa teneur en phosphore et en arsenic encouragea les sidérurgistes à le remplacer peu à peu par des minerais d’outre-mer plus riches (teneurs moyennes de l’ordre de 60 %). Les mines de fer de Lorraine ont peu à peu cessé d’être exploitées. La dernière à avoir fermé, en 1997, est celle des Terres Rouges à Audun-le-Tiche (Moselle).
Quittons la théorie de ce monde souterrain et recherchons en surface les traces laissées par l’activité minière. Elles sont nombreuses et parfois surprenantes. On peut rencontrer une clôture bien solide formée de fleurets, rails et traverses.

Dans les villages des berlines sont reconverties en éléments décoratifs qui perpétuent le souvenir.

Ailleurs cette jolie falaise rouge est en fait le front de taille d’une exploitation à ciel ouvert.
Les différentes
strates sont baptisées d’après leur couleur. Ici nous sommes face à la Couche Rouge. Ce type d’excavation au volume impressionnant peut recouper des galeries souterraines plus anciennes.

Un peu plus loin nous trouvons un autre témoignage du passé sous la forme d’ un signe cabalistique gravé sur le sommet de cette borne. En fait il matérialise les limites de 3 concessions minières. Ce vestige rare résistera t’il à l’appétit des pelleteuses? On peut en douter en constatant leur boulimie.

Dans un fond de vallée un petit ru (qui serpente etc.) attire notre attention et nous constatons que sa sortie de terre est aménagée. Il s’agit vraisemblablement de la sortie d’une exhaure dont nous soupçonnions l’existence dans ce secteur.
Cette source solidement grillagée est également une exhaure.
Qu’y a-t-il derrière? Mystère , mais en tout cas cette bouche de minette souffle une haleine glaciale.

Si la mine a laissé des traces, les vestiges industriels se font plus rares, les hauts fourneaux ont été démantelés et on imagine facilement le drame humain qu’a provoqué l’arrêt de toute cette filière. Cela donne l’impression que l’on veut effacer tous souvenirs de cette période florissante, à moins qu’il ne s’agisse plus prosaïquement de l’appétit des promoteurs immobiliers.Heureusement, tout proche d’un carreau de mine, on peut admirer un accumulateur de minerai classé monument historique.En fonction de la couche dans laquelle il est extrait le minerai possède des qualités différentes. Amené par les berlines il était trié et stocké à l’intérieur des silos de l’accumulateur en
fonction de ses différentes destinations

La région était pourvue en fonderie, aciérie etc. et il est amusant de constater que le fer qui sortait de la mine sous forme de minerai y retournait une fois transformé en rails , IPN, etc. Les rails de second choix étaient employés comme soutènements. Les résidus des fonderies servaient de ballast, le
laitier servait quant à lui à la fabrication de briques que l’on retrouve dans les galeries de roulage. Au vu de la densité des soutènements dans certaines galeries, on peut se poser la question s’il n’est pas rentré plus de fer qu’il n’en est sorti !

Nous avons terminé notre périple devant l’entrée du Musée d’Hussigny où la rouille nostalgique a encore fière allure.